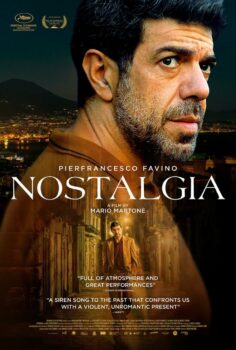Je verrai toujours vos visages
Jeanne Herry, la réalisatrice de ce soir fête tout juste ses 45 ans puisqu’elle est née un 19 avril 1978. Fille du chanteur Julien Clerc et de l’actrice Sylvette Herry, plus connue sous le surnom de Miou-Miou, baptisée ainsi par un amour de jeunesse, un certain Coluche, pour sa petite voix, qui faisait penser au miaulement d’un chat.
Enfant de la balle, Jeanne Herry fait sa première apparition au cinéma à l’âge de 11 ans aux côtés de sa mère dans Milou en mai de Louis Malle.
Adolescente, elle hésite entre le métier d’avocate et celui d’actrice et s’engage finalement sur les pas de sa mère. Bac économique en poche à 16 ans, elle suit d’abord une école de théâtre au London and international School of acting. Puis de retour à Paris, elle échoue à l’audition d’un conservatoire de quartier et manque de tout abandonner mais elle se ressaisit et accède au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris au début des années 2000 où elle va découvrir la mise en scène.
Après ses années de formations, elle entame une carrière de comédienne dans des téléfilms mais aussi au théâtre, où elle joue et signe des mises en scène. En parallèle, elle écrit un roman autobiographique 80 années et réalise des courts puis des longs métrages au cinéma.
Je verrai toujours vos visages est son 3ème long métrage après Elle l’adore en 2014 et Pupille en 2018.
Jeanne Herry nous fait découvrir la justice restaurative méconnue du grand public.
Directement inspirée des pratiques de justice ancestrales, ce dispositif a émergé en France au milieu des années 2000 grâce aux travaux du Pr Robert Cario, Criminologue à l’université de Pau et fondateur de l’Institut Français pour la Justice Restaurative. Christiane Taubira, garde des Sceaux l’introduit ensuite en 2014 dans le code pénal. Sa mise en œuvre est effective depuis 2017 et à ce jour, il y a peu de pays en Europe où la justice réparatrice n’est pas, au minimum, expérimentée.
Deux sortes de mesures ont majoritairement été mises en place : les cercles qui sont des groupes de rencontre entre victimes et auteurs d’agression, qui mettent face à face trois ou quatre victimes et trois ou quatre condamnés, ayant commis des actes similaires à ceux vécus par les victimes, en présence de deux animateurs et de deux autres personnes bénévoles ; et les médiations, qui offrent à la victime la possibilité de rencontrer son agresseur.
La justice restaurative, en complément de la sanction pénale, vise à la fois à rétablir le lien social et à mieux prévenir la récidive chez l’auteur du délit mais contribue aussi à la réparation de la victime.
Son exercice bénéficie d’un cadrage rigoureux. Pour avoir lieu, ces rencontres nécessitent la reconnaissance des faits par le condamné, l’information des participants et leur consentement, la présence obligatoire d’un tiers indépendant et formé, un contrôle de l’autorité judiciaire et la confidentialité des échanges.
Pour vous donner un ordre de grandeur sur cette mesure de justice trop peu connue mais qui suscite de l’intérêt, on dénombre en 2022[1] :
83 mesures en cours de réalisation auprès de 131 bénéficiaires ; 1684 personnes formées pour coordonner et animer les mesures (conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, psychologues, éducateurs spécialisés, juristes, directeurs d’association de victimes, …) et près de 500 retraités bénévoles.
Pour construire cette fiction extrêmement documentée, Jeanne Herry s’est immergée à 200% dans le monde pénitencier. Elle a suivi les formations d’animateur et de médiateur. Elle s’est adjoint l’expertise technique de Noémie Micoulet de l’Institut Français pour la Justice Restaurative qui lui a permis de rencontrer des professionnels aguerris et de faire évoluer l’écriture du scénario.
Elle a poursuivi par des lectures en tête-à- tête avec chaque acteur en amont du tournage pour caler précisément le texte qu’ils auraient à jouer à la virgule près.
Les 3 semaines de tournage se sont déroulées en studio sous une lumière artificielle, mettant en scène des personnages liés par leurs destins, assis en rond toujours au même endroit, et s’exprimant principalement par leur voix et leur visage.
Comme vous allez le découvrir, ce film choral est porté par un casting assez exceptionnel d’acteurs pour la plupart bien connus du grand public avec, entre autres, Leïla Bekhti, Gilles Lellouche, Miou-Miou, Fred Testot, Adèle Exarchopoulos, Jean-Pierre Darroussin … mais aussi Dali Benssalah, Suliane Brahim et Birane Ba.
Bon film !
Doris ORLUT
[1] Source Institut Français pour la Justice Restaurative