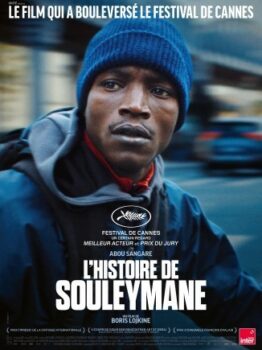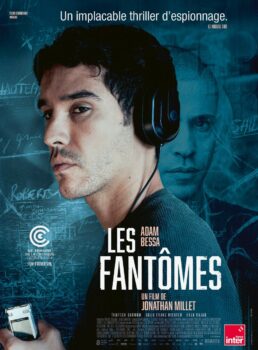Le procès du chien, Laetitia Dosch
Laetitia Dosch a 44 ans, elle a suivi une formation de comédienne de théâtre en France puis en Suisse, elle a donc d’abord joué sur les planches dans des pièces de Tchekov, Brecht ou Shakespeare. Son 1er grand rôle au cinéma lui est offert en 2013 par Justine Triet, dans la Bataille de Solférino. Elle tourne ensuite sous la direction de C Corsini, Maiwenn, C Honoré et bien d’autres. On a pu la voir très récemment dans Le roman de Jim, des frères Larrieu, où elle interprète la mère de Jim.
Le procès du chien est le 1er film qu’elle réalise, mais ce n’est pas la 1ère fois qu’elle s’intéresse dans ses spectacles aux êtres non humains : elle avait par exemple partagé la scène avec un cheval en 2020, et elle pense qu’il faut réinventer note rapport aux autres êtres vivants. Ainsi, ce qui l’a interpellée dans le sujet de ce film, c’est que la loi suisse assimile le chien à une chose, si bien que s’il est euthanasié on considère qu’il est détruit et non tué. Le film est d’ailleurs inspiré d’un fait divers réel, dans lequel un maître chien a été accusé pour des morsures portées par son chien, ce qui a enflammé toute une ville. Or selon la réalisatrice, c’est un sujet qui demande au contraire du calme et des discussions apaisées.
On voit aussi que LD s’intéresse particulièrement aux personnages marginaux comme le maître du chien, le petit voisin punk de la l’avocate ou encore Anabela, la femme mordue par le chien et qui décide de garder ses cicatrices, de refuser la norme, incarnant ainsi une forme de féminisme. Mais le film établit aussi un lien étroit entre le chien Cosmos, l’accusé dans le film, et l’avocate des causes perdues, interprétée par la réalisatrice, tous 2 cherchent leur voix et c’est en voulant le sauver qu’elle va trouver la sienne.
Quelques mots sur l’image de ce film. Si vous observez attentivement les couleurs, vous verrez que le tribunal a des couleurs à la fois plus acidulées et plus douces, pour créer une sorte de bulle, d’espace protégé. Le chef opérateur, Alexis Kavyrchine, est le même que pour le film La fille de son père ou pour le film de Klapish, En corps.
Enfin, la réalisatrice a essayé dans cette comédie de faire jouer ensemble différents types de comiques, de la satire caricaturale avec le personnage de l’avocate de la partie civile interprété par Anne Dorval, et qu’elle a imaginé comme une sorte d’Eric Zemmour ou de Donald Trump, à JPascal Zadi qui a un jeu assez neutre alors que François Damiens est davantage dans l’outrance, en passant par le personnage qu’elle interprète et qui n’a pas peur de faire des grimaces.
A noter: le chien qui interprète Cosmos a reçu la Palme Dog à Cannes !